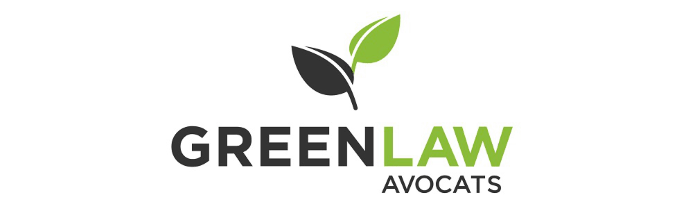Par
Sébastien BECUE et David DEHARBE
Green Law Avocats
Si l’avènement annoncé d’un permis environnemental unique valant à la fois – et entre autres – permis de construire et autorisation d’exploiter au titre de la législation ICPE[1] devrait un jour permettre de mettre un terme à cette absurdité, les porteurs de projets industriels restent pour l’heure soumis au risque de subir deux procédures d’annulation, l’une devant le juge de l’urbanisme et portant sur les caractéristiques de construction, et l’autre devant le juge des ICPE et portant sur les effets du projet sur les intérêts environnementaux.
Or l’habitué du contentieux environnemental sait que l’intérêt à agir du tiers requérant a longtemps été plus aisément accueilli par le juge de l’urbanisme que par son collègue environnementaliste[2].
Cette différence s’est amenuisée depuis l’adoption du nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en 2013[3], disposition issue des réflexions du groupe de travail dirigé par Daniel LABETOULLE[4], et qui vise à encadrer plus strictement la définition de l’intérêt à agir contre les autorisations d’urbanisme[5].
Ainsi un tiers requérant[6] « n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu'[il] détient ou occupe régulièrement ou pour lequel [il] bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation [contrat de réservation dans le cadre d’une VEFA] ».Cet encadrement légal de l’appréciation par le juge de l’intérêt à agir est pour ainsi dire inédit dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Désormais, le juge est tenu de vérifier que le requérant est directement et réellement affecté par le projet qu’il attaque. Selon ses inspirateurs, sans que cette subjectivisation de la preuve de l’intérêt à agir soit destinée à s’écarter « de la jurisprudence qui s’est développée en l’absence de texte », elle a pour objet de donner aux juges administratifs « comme un signal les invitant à retenir une approche un peu plus restrictive de l’intérêt pour agir ».Aux termes d’une désormais fameuse[7] décision Brodelle (CE, 20 juin 2015, n°386121, publiée au recueil Lebon), le Conseil d’Etat décide d’étendre la portée de la disposition, en définissant précisément les éléments de preuve que doivent apporter chacune des parties au procès de l’autorisation d’urbanisme, lorsqu’est posée au juge administratif la question de l’intérêt à agir du requérant.
Premier appelé à s’exprimer, le requérant est tenu de préciser l’atteinte invoquée, « en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ». Le défendeur peut alors opposer à son tour « tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ». A partir de ces soumissions, le juge doit « former sa conviction », « en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ».
Le Conseil d’Etat franchit ainsi une première étape. Il ne suffit désormais plus que le requérant soit affecté, il faut désormais qu’il le démontre. Il ressort en effet de ce considérant que le juge n’est libre d’apprécier l’atteinte que subit le requérant que si ce dernier l’invoque et la démontre.
Une seconde étape est franchie début 2016 lorsque le Conseil d’Etat décide de confirmer la décision d’un président de tribunal administratif qui rejette, par ordonnance[8] – une requête pour défaut manifeste d’intérêt à agir (CE, 10 fév. 2016, n°387507, Peyret, mentionné aux Tables). Même si ce n’était pas la première fois que l’utilisation des ordonnances de tri pour défaut d’intérêt à agir est autorisée[9], le Conseil d’Etat ne l’avait jamais fait de manière aussi claire.
La conjonction de ces deux évolutions a laissé craindre un durcissement excessif des conditions d’accès au juge de l’urbanisme.
Il s’est depuis avéré que ces requérants semblent avoir payé un tâtonnement jurisprudentiel. En effet, seulement deux mois après cette décision, sur proposition du rapporteur public Rémi DECOUT-PAOLINI, le Conseil d’Etat infléchit grandement sa position, en instaurant, en ajout au considérant Brodelle, une facilité probatoire pour le voisin immédiat du projet (CE, 13 avril 2016, n°389798, Bartolomei, Publié au recueil Lebon).
Ces décisions et cette évolution de l’intérêt à agir ont été commentées par la doctrine sous un angle jurisprudentiel[10] ou théorique[11] ; nous nous proposons d’en étudier les conséquences pratiques, notamment en termes de stratégie contentieuse, pour les parties au procès et en prenant ouvertement le point de vue des « usages professionnels » du prétoire.
- Le voisin immédiat requérant légitime
En matière d’intérêt à agir contre le permis de construire, le doute profite encore et toujours au voisin immédiat : c’est là l’enseignement essentiel de l’arrêt Bartoloméi.
Le Conseil d’Etat y fait valoir : « eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » (CE, 13 avr. 2016, n°389798, précité).
Le voisin immédiat est donc exonéré de l’artifice procédural selon l’expression de la rapporteur public Aurélie BRETONNEAU, consistant à imposer au requérant d’invoquer une atteinte émanant du projet autorisé et de préciser en quoi cette atteinte affecte son bien.
Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, le voisin immédiat doit tout de même établir qu’il dispose de la « situation particulière » requise, à savoir une proximité géographique immédiate avec la construction projetée.
Une fois sa qualité de voisin immédiat établie, il ne reste plus au requérant qu’à confirmer en produisant des pièces relatives à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction projetée, ce qui devrait se révéler relativement aisé, ces caractéristiques étant généralement présentées dans le dossier de demande de permis de construire, dont il peut demander copie en mairie ou en préfecture. Et bien évidemment si l’autorité d’urbanisme tarde à transmettre au tiers le dossier de permis (ce qui est rare mais pourrait bien devenir plus fréquent, vu les enjeux), une saisine de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) réglera normalement la difficulté en quelques semaines.
Etablir l’intérêt à agir contre le permis de construire dans le cas du voisin immédiat n’est donc pas devenue chose particulièrement redoutable.
Fondamentalement cette situation du voisin immédiat ne rompt pas avec celle qui était la sienne sous l’empire de la jurisprudence antérieure et des critères juridictionnels de son appréciation (cf. pour exposé du droit avant la réforme : J. Moreau : « L’intérêt à agir dans le contentieux administratif de la légalité en matière de permis de construire », in Mélanges E. Langavant, 1998, p. 317, et C. Vigouroux, « Intérêt pour agir et urbanisme : où en est la jurisprudence », BJDU 1994/5).
En effet pour caractériser la situation de voisinage et admettre l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat exigeait des juges du fond qu’ils se réfèrent à la distance entre l’immeuble du requérant (voir CE, 14 septembre 1994, Commune de Montdidier, req. n°112343) à la configuration des lieux (CE, 2 juin 1993, Planfetti, req. n° 130453) ou encore à la nature et à l’importance de la construction (voir CE, 25 novembre 1998, Mme Chèze, req. n° 162926 ; Rec. CE 447 ; CE 15 avril 2005, Association des citoyens et contribuables de la communauté de communes de Soane et Vienne ; req. n° 273398 ; Dr. adm. 2005, n° 109, note Cassia).
Mais si la chose n’est pas redoutable elle peut le devenir et ceci pour toutes les parties.
Pour le requérant présomptueux de son intérêt à agir, encore faut-il que son recours en excès de pouvoir satisfasse aux conditions de recevabilité de l’article L. 600-1-2, à savoir que le projet soit « de nature à affecter directement (…) ». Car le défendeur aura le loisir de démontrer que, malgré sa qualité de voisin immédiat, le requérant n’est pas in concreto affecté par la construction projetée. Ainsi, peut-on citer cette espèce récente qui, eu égard aux faits singuliers de l’espèce, témoigne des défenses fouillées qui sont parfois envisagées : « Il ressort des pièces du dossier que M. E. est propriétaire d’une parcelle à Saint-Romain-la Virvée cadastrée n° 189, qui jouxte le terrain d’assiette du projet contesté. Cette parcelle, dont l’entrée se situe route du Pouyau, est formée d’un étroit chemin de trois mètres de large sur cinquante-cinq mètres de long donnant accès à un carré de 10 mètres sur 10 mètres, formant une encoche dans la parcelle de M.D…. M.E…, qui n’habite pas sur cette parcelle, se prévaut de ce qu’en tant que » gardien moral et réel de la chose « , il est tenu d’assurer la protection du monument funéraire implanté en fond de parcelle ainsi que le caractère paisible et bucolique des lieux auquel il serait porté atteinte par le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que les défunts inhumés sur la parcelle en cause ne sont pas des membres de sa famille, d’une part, le caveau, n’est pas entretenu, d’autre part, le volet paysager du projet garantit le maintien d’une strate arbustive et arborée à proximité du chemin formant la première partie de la parcelle et prévoit en particulier la plantation de deux chênes en limite de propriété avec le monument funéraire. Dans ces conditions, M. D. établit que le projet en cause n’est pas de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M.E…, au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager contesté » (CAA Bordeaux, 31 mai 2016, n°15BX02051).
On ne peut donc que conseiller au voisin immédiat de ne pas se borner à décrire sa position et les caractéristiques de la construction projetée, ce à quoi pourrait encourager une mauvaise lecture de la décision Bartoloméi, mais plutôt à démontrer de la manière la plus précise possible, comme tout requérant, en quoi il est directement et personnellement affecté par le projet.
Malgré ce piège, il est certain que la position du voisin immédiat est beaucoup plus confortable que celle du requérant lambda, en ce qu’il semble moins menacé par une éventuelle insuffisance formelle de sa requête.
- Le requérant lambda, exposé à l’irrecevabilité manifeste
Pour le voisin non-immédiat, la tâche s’annonce beaucoup plus ardue, et sa position, à l’inverse, précarisée. Il est d’emblée tenu de se défendre en renversant la présomption d’absence d’intérêt à agir résultant de son éloignement. S’il n’est pas proche de la construction, comment pourrait-il en effet être affecté par elle ?
L’exigence nouvelle du juge administratif résultant des décisions Brodelle et Peyret veille à ce que l’intérêt du tiers requérant se rattache à un motif d’urbanisme. Tout comme l’intérêt purement commercial se voit notamment exclu (C.E., Sect., 5 octobre 1979, S.C.I. Adal d’Arvor, Rec. C.E., p. 365) à l’instar de celui du concurrent (C.E., 22 fév. 2002, 216088, mentionné aux tables du recueil Lebon) de même que les justiciables qui poursuivent une prétention purement philosophique (C.E. 29 juillet 1983, Fédération départementale des libres penseurs des Yvelines, Rec. C.E., p. 357) ou exclusivement social (C.E. 1er décembre 1993, Comité d’entreprise de la Société française de munitions, Rec. C.E. tables, p. 1116, BJDU 2/1994, p. 111).
Le niveau d’exigence fixé par le Conseil d’Etat est particulièrement élevé puisqu’il doit faire état « de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».
Et si la démonstration n’est pas au niveau, le requérant s’expose désormais à voir sa requête rejetée par ordonnance. Il lui faut donc se prémunir en rédigeant des développements sur la recevabilité qui doivent s’apparenter à un moyen de fond, en montrant que l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée au bénéficiaire l’a été en méconnaissance de ses droits de voisin.
Cette exigence formelle, consistant à attendre du requérant qu’il inscrive « noir sur blanc » dans la requête l’atteinte invoquée et ses effets sur sa situation, nécessite pour lui de disposer de quelques connaissances juridiques ou, à tout le moins, de la capacité de rédiger une argumentation.
Surtout le requérant doit fournir des pièces tangibles et crédibles établissant cette atteinte ; sans toutefois, comme le Conseil d’Etat le rappelle fort logiquement dans Brodelle, que le juge puisse exiger que soit démontré le caractère certain de cette atteinte, par essence future. Dans tous les cas, l’obtention de pièces permettant d’établir une atteinte émanant d’un projet situé à une certaine distance sera compliqué, soit qu’il y ait à faire appel à un expert – huissier, bureau d’études, architecte – solution forcément coûteuse, ou à un travail personnel du requérant de recherche fouillée.
Il y a fort à parier que certains particuliers ne parviendront pas à atteindre ce niveau d’exigence, et ce, malgré la demande de régularisation de la requête que le greffe est tenu de transmettre au requérant avant de prendre son ordonnance de tri. Ce risque vient s’ajouter à celui de la fréquente méconnaissance, par les requérants non conseillés, de l’obligation de notification de la requête à la partie adverse et à celui de l’amende pour recours abusif qui si elle n’a jamais été appliquée, dispose d’un effet psychologique indéniable que les praticiens constatent.
Le requérant qui sait qu’il ne disposera pas de la qualité de voisin immédiat aura donc tout intérêt à développer des stratégies de contournement. S’il dispose d’un soutien de l’opinion local, il peut ainsi chercher à constituer une association de riverains. Au-delà des conditions traditionnelles de l’appréciation de l’intérêt à agir des associations, on rappellera sur ce point deux développements récents.
D’une part, le fait qu’une telle association doit être constituée suffisamment tôt, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme conditionnant son intérêt à agir au dépôt des statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme.
D’autre part, il existe un courant jurisprudentiel[12], qui s’est développé en matière d’urbanisme commercial selon lequel une association n’est pas recevable s’il « ressort manifestement des pièces du dossier que l’association agit exclusivement pour le compte d’autrui et dans un but autre que celui qu’elle est censée poursuivre à travers son objet social » (CAA Douai, 30 mars 2006, n°04DA00016) ». Le Tribunal administratif de Lille a récemment fait application de ce principe à l’encontre d’une association constituée de riverains pour contester l’autorisation d’un arrêté préfectoral approuvé le projet d’interconnexion électrique, entre la France et l’Angleterre sur les communes de Peuplingues et Sangatte, au prétexte qu’un requérant dont l’intérêt à agir individuel avait été dénié pour contester le permis de construire de la même installation était à l’origine de la constitution de l’association (TA Lille, ord. 19 juillet 2016, Association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et autres, n°1510006) : « que Mme X, présidente de cette association, et M. Y, son trésorier, ont précédemment formé, le 14 octobre 2014, un recours tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire portant sur la station de conversion électrique nécessaire à la réalisation du projet d’interconnexion ; qu’il ressort des pièces du dossier, que lors de sa création les époux Y et X étaient les seuls membres de cette association, dont le siège est au domicile de M. X ; que les intéressés ,qui ont implicitement admis dans leur mémoire enregistré le 28 décembre 2015, être avec leurs conjoints les seuls membres de l’association mais, avoir pour objectif de « recruter d’autres membres », ont produit postérieurement à l’audience de référé qui s’est tenue le 29 décembre, une décision du conseil d’administration datée du 27 novembre 2015 ; que par cette seule et même décision , 17 nouveaux membres auraient été intégrés dans l’association requérante, dont certains appartiennent à la famille de M. Y, et ne résident pas, pour neuf d’entre eux, sur les communes concernées ; que l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie des communes de Peuplingues et de Sangatte, dont l’intérêt à agir est contesté, n’a pas fait état dans le cadre de la présente instance d’activités autres que cette seule action en justice dirigée contre la décision d’approbation en litige ; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’association requérante a été régulièrement constituée et a pour objet de « protéger (….) la santé et la sécurité des personnes, (….) les sols et sous-sols, (…), de lutter contre les pollutions et nuisances, contre les projets générateurs de risques pour la santé publique ou de détérioration des sols ou sous-sols (…). », il apparaît que, sous couvert d’un tel objet, ladite association n’a pas d’intérêts réellement distincts de ceux que M. Y et Mme X entendent défendre dans le cadre de la présente instance ». Cette incursion du juge dans les conditions de formation de l’association pour vérifier la réalité de son intérêt à agir, au demeurant non censurée par le Conseil d’Etat (le pourvoi formé contre l’ordonnance n’a pas passé le cap de l’admission), fait assurément écho aux développements jurisprudentiels consécutifs à la réforme Labétoulle.
A la stratégie des riverains pour contourner l’exigence d’un intérêt à agir subjectif, le juge administratif semble ainsi désormais prêt à rompre avec son libéralisme en la matière, quitte même à forcer sa jurisprudence sur la transparence des associations. S’agit-il seulement de sécuriser les autorisations d’urbanisme ou plus fondamentalement d’alléger le rôle de juridictions surchargées (du moins avant la crise), quitte à concéder quelques entorses au du droit au procès équitable ? Les deux considérations dans des proportions incertaines expliquent sans doute ce durcissement. En tout état de cause, les justiciables et leurs conseils devront réfléchir le plus amont possible aux moyens de démontrer les chances d’aboutir d’une action portée par une associations de riverains, en portant une attention aux qualités de ses membres et à la date de leur adhésion, qui ne doit pas être trop rapprochée de la celle du dépôt du recours.
- Le bénéficiaire et le juge confortés
Conformément à l’objectif assigné à la nouvelle définition de l’intérêt à agir, la position du porteur de projet est plus confortable qu’auparavant, sans pour autant être bouleversée.
Parmi les constantes, le constructeur reste soumis à l’aléa judiciaire, ce qui peut lui poser des problèmes de financements, les banques étant forcément moins enclins à délivrer des fonds pour un projet encourant un risque d’annulation, fut-il limité.
Au point que certains constructeurs préfèrent commencer à construire en espérant que les requérants formeront un référé-suspension qui leur permettra d’obtenir un premier avis judiciaire sur le dossier qu’ils pourront présenter – s’il est favorable – à leurs financeurs.
La requête en irrecevabilité manifeste pour défaut d’intérêt à agir peut également jouer ce rôle, en forçant le demandeur à justifier plus solidement ses atteintes et donc à dévoiler ses atouts plus tôt. Elle peut aussi décourager certains requérants qui, exposés à un démontage en règle de leur requête, perdraient foi dans leurs chances de succès, et décideraient soit de se désister, soit de ne pas répondre à la requête en irrecevabilité manifeste, s’exposant ainsi à voir le juge statuer sur les seuls éléments fournis par le défendeur.
Le bénéficiaire doit toutefois prendre garde à ne pas confondre fin de non-recevoir et fond car à trop exiger de la démonstration de l’intérêt à agir du requérant, on peut faire pire. A minima on alourdira inutilement le débat contentieux, mais si le Tribunal cède à la tentation de se débarrasser du contentieux en étant trop exigeant, le défendeur n’est pas non plus à l’abri d’une censure du juge d’appel ou de cassation selon que la fin de non-recevoir aura été accueillie en formation collégiale ou par ordonnance de tri. Or pour le pétitionnaire d’un projet qui nécessite un permis purgé faire traîner la procédure contentieuse c’est jouer le jeu du tiers requérant.
Quant au juge face à une telle configuration, il est finalement contraint d’instruire d’une certaine façon au fond la question de l’intérêt à agir car la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat lui impose de scruter les pièces du permis lorsqu’elles auront été jointes s’il veut se défaire au plus tôt et donc par ordonnance du dossier. Il n’est pas certain que cette instruction prématurée soit compatible avec la pratique qui consiste à ouvrir le dossier plusieurs mois après le dépôt de la requête…
La meilleure stratégie pour le constructeur porteur de projet reste de connaître ses potentiels futurs adversaires en étant proactif avant le dépôt de la demande de permis de construire. Si le projet est soumis à étude d’impact ou étude de dangers, voire, s’il n’y est pas soumis, directement dans son dossier de demande de permis de construire, il a tout intérêt à préparer sa future défense en consacrant des développements sur l’absence d’effet de son projet sur les voisins.
In fine et au-delà de ces considérations pratiques sur le rôle des parties, on rappellera que la reconnaissance d’un intérêt à agir contre un permis de construire dépendra toujours et fondamentalement, comme l’exprime Pierre SOLER-COUTEAUX « de la plus ou moins grande proximité du projet contesté car, en fonction de ce paramètre, l’intérêt peut aller suffisamment de soi au regard des pièces du dossier ou, au contraire, requérir une argumentation plus étayée » (RDI 2015, p.434, note sous CE, 10 juin 2015, n°386121).
[1] En l’état du droit réservé aux seuls projets éoliens et de méthanisation.
[2] En vertu de l’article L. 514-3-1 du code de l’environnement et de l’interprétation qu’en a fait le Conseil d’Etat dans sa décision Moulins Soufflet (CE, 13 juil. 2012, n°339592, mentionné aux Tables), les requérants tiers sont tenus de justifier, lorsqu’ils forment un recours à l’encontre d’une décision prise au titre de la législation des ICPE, d’un « intérêt suffisamment direct (…) compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ».
[3] Via l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013.
[4] Exprimées dans un rapport intitulé « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », remis le 25 avril 2013 à Cécile DUFLOT, alors Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement.
[5] Voir J. Tremeau, « La régulation de l’accès au prétoire : la redéfinition de l’intérêt à agir », AJDA 2013 p. 1901.
[6] Autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association.
[7] Son considérant étant systématiquement repris dans sa totalité par le juge administratif statuant sur l’intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
[8] C’est-à-dire sans débat contradictoire ni tenue d’une audience, mais avec tout de même l’obligation pour le juge de demander au requérant la régularisation de sa requête.
[9] Voir CE, 23 juil. 2014, Fédération des syndicats de fonctionnaires, n°362559.
[10] CE, 10 juin 2015, n° 386121, M. Brodelle et Mme Gino, au Lebon ; AJDA 2015. 1183 ; RDI 2015. 434, obs. P. Soler-Couteaux ; RFDA 2015. 993, concl. A. Lallet . CE, 10 févr. 2016, n° 387507, au Lebon T ; AJDA 2016. 286 ; ibid. 971 , concl. A. Bretonneau. RDI 2016 p. 422. CE, 13 avril 2016, n° 389798, Bartolomei, au Lebon ; AJDA 2016. 752 ; JCP A 2016, n° 2127, note D. Tasciyan ; RDI 2016. 422, obs. P. Soler-Couteaux. A. Durup de Baleine, « Intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme », AJDA 2015. 2095.
[11] J. Sirinelli, « La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir », RFDA 2016 p.529.
[12] Voir par exemple CAA Douai, 30 mars 2006, n° 04DA00016.